L’art culinaire en Tunisie au confluent des traditions méditerranéennes
Mohamed Yassine Essid
Professeur des universités
Département d’histoire
Département des Etudes anglaises
faculté des lettres et sciences humaines de Tunis
1. Aux sources de l’alimentation tunisienne
Avant que la plupart des peuples ne commencent à produire industriellement ces denrées de toutes sortes offertes aujourd’hui sur nos marchés et libérées de la tutelle des saisons et des climats, et avant que nos goûts héréditaires instinctifs ne s’estompent et notre appétit s’internationalise, on consommait en Tunisie ce qu’on produisait, et le régime alimentaire du Tunisien demeura, pendant deux millénaires, fidèle à ses origines méditerranéennes.
A l’examen, on se rend compte que cette cuisine, réputée si typique, si particulière, est en fait au confluent de toutes les traditions locales, qu’elle utilise les techniques anciennes, qu’elle adopte certains éléments exotiques en enrichissant le tout par une complexité et un raffinement plus grand. Une civilisation se détermine par ce qu’elle adopte, intègre, assimile et acclimate raisonnablement et efficacement. De ce point de vue, la Méditerranée a su s’imprégner avec génie des influences extérieures en accommodant les produits étrangers provenant d’Asie centrale, d’Asie occidentale et d’Amérique tropicale. Des épices,

des plantes aromatiques, des fruits et des légumes ont ainsi accompagné les migrations des peuples et des plantes. L’ail est originaire des steppes d’Asie centrale. Le safran, celui qui colore et parfume à la fois, vient d’Asie Mineure. De l’Extrême Orient on a importé cannelle, cardamome, clous de girofle, gingembre, noix muscade, poivre, cubèbe macis, bétel, musc. D’Afrique proviennent sésame et sorgho et le pêcher venu de Chine. L’aubergine, l’artichaut, la pastèque (de l’arabe battîkh), le melon, l’abricotier, le citronnier et le bigaradier, le haricot, la pomme de terre et le figuier, pourtant si typiques, ne sont pas nés sur le sol de la Méditerranée. Indispensables à la cuisine méditerranéenne et originaire du bassin de la Méditerranée cette fois, les plantes aromatiques et des légumes condimentaires tels le laurier ou le genévrier, l’hysope, la marjolaine, la menthe, la sarriette, le cerfeuil, le persil, la menthe, la rue, le thym, le serpolet, la lavande, l’aneth, la mauve, le pourpier, les câpres, le fenugrec, la laitue, le carthame, le carvi, le pavot, les feuilles et les boutons de rose, la pistache, le sumac, la moutarde, l’ail et l’oignon. Chaque conquête, chaque vague d’immigrants est aussi l’occasion de l’intégration et assimilation de produits et de savoir-faire culinaires nouveaux. Chaque communauté qui s’installe, pour se conserver, adapte ses pratiques et ses traditions alimentaires aux conditions et aux possibilités locales par l’utilisation de certains condiments ; elle transmet aussi aux populations locales des usages et la consommation de certains produits jusque-là inconnus. Ce fut le cas de l’influence des andalous sur l’extension, en Occident musulman, des produits et des épices d’origine américaine : piment, tomate, arbres fruitiers. Si cette cuisine a mérité son qualificatif de méditerranéenne, c’est parce qu’elle a su imposer un mode commun de transformer les aliments, de corriger leurs défauts par l’art des assaisonnements et de compenser les manques par la substitution de certains produits à d’autres.

L’apport phénicien.
L’alimentation en Tunisie plonge ses racines dans le vaste monde culturel du Proche-Orient où l’on faisait une grande consommation de céréales : épeautre, blé et orge. Ces céréales étaient consommées sous forme de bouillie, de pain et de galettes de blé de différents types. Cette alimentation à base de céréales était complétée par des légumineuses : petits pois, lentilles, pois chiches fèves, et par l’huile d’olive, qu’on produisait en Syrie et en Palestine dès le IIIe millénaire ainsi que par les nombreux fruits comme les dattes, figues, pommes, grenades, coings, amandes, pistaches, etc. Extrêmement sucrée, dattes, figues et raisins, frais ou séchées, remplaçaient dans l’alimentation des pauvres de l’époque des substances adoucissantes plus coûteuses telles que le miel. On retrouve encore ces fruits dans des mets comme la laklouka du Sahel ou de Kerkennah. On consommait aussi du vin à partir de la culture de la vigne. Quant à la viande, elle provenait de l’élevage des bœufs, des moutons, des animaux de basse-cour et de la chasse. Homère raconte que les Phéniciens commerçaient avec la Libye qu’il décrit comme une terre riche en bétail et donc en viande, en lait et en fromage. L’extraction du sel était complémentaire de la pêche. Le domaine forestier était important et recelait un important gibier, cerfs, antilopes, gazelles, sangliers.

La civilisation de Carthage
La civilisation de Carthage était caractérisée par le plein développement agricole. Consciente de la précarité d’une économie entièrement subordonnée au commerce méditerranéen, la Cité s’était engagée dans une politique agricole comme le montre le Traité d’Agriculture en 20 volumes, rédigé au 5ème siècle, par Magon. Les sources classiques nous fournissent en effet toute une série d’informations sur l’alimentation des Carthaginois, surtout à la fin de la période punique, nous permettant de reconstruire une histoire de la production et des habitudes alimentaires de la première phase de la colonisation phénicienne de l’Occident. Sans doute, ces colonies avaient-elles conservées les traditions alimentaires de la mère patrie. Mais ces traditions orientales se sont ensuite adaptées aux coutumes locales, marquées par la géographie des régions occidentales.
L’arrivée des Romains en Tunisie va permettre à l’agriculture de faire un grand bond transformant l’Ifriqiya en grenier à blé de l’Italie grâce surtout aux systèmes d’irrigation qu’ils avaient mis en place permettant ainsi l’extension des zones de culture céréalières jusqu’à Sfax et Gafsa. Quatre cultures dominaient :
- Le blé concentré surtout au nord. Les besoins de céréales étaient importants à Rome car les paysans avaient déserté la campagne pour la ville et l’Italie n’était plus autosuffisante en blé alors que la nourriture de base était sous forme de bouillie et de pain et qu’il fallait approvisionner régulièrement le peuple.
- L’orge qui se cultivait surtout dans le centre et le sud et servait à nourrir une partie de la population.
- La vigne dont la culture fut introduite par les Tyriens établis à Carthage.
- Il y avait également une importante culture d’arbres fruitiers et de légumes : figuiers, grenadiers, jujubiers, dattiers couvraient de grandes étendues. On doit citer les primeurs, et parmi eux les artichauts de Carthage, et parmi les légumes, les fèves.
- La culture de l’olivier, inaugurée par les Phéniciens, constitua, dès cette époque, la grande richesse de la Tunisie. Des forêts d’oliviers s’étendaient surtout dans le Centre et le Sud du pays. L’huile, dont la fabrication ne s’améliora qu’à partir du IVe siècle, était exportée vers la Sicile et l’Italie et partout servait non seulement à la consommation mais aussi à l’éclairage et aux soins de toilette.

A la veille de l’arrivée des conquérants musulmans, cette partie de l’Afrique du Nord méritait encore le titre de « grenier à céréales ». En 608, Héraclius le savait si bien qu’il n’hésita pas à s’en servir contre Constantinople en suspendant les envois de blé et peut-être de l’huile vers la capitale. L’élevage des ovins se développa surtout par le canal de l’Egypte et de la Libye que le mouton pénétra la Tunisie.
L’influence arabe et islamique :
L’alimentation après la conquête musulmane continue celle qui était en usage avant l’Islam. Le seul fait nouveau et d’importance réside essentiellement dans la réglementation musulmane relative à l’alimentation. Le Coran qui, par ailleurs, insiste sur le caractère bénéfique de l’alimentation et considère la nourriture comme un des principaux bienfaits divins, interdit le vin et bannit absolument de l’alimentation des Musulmans la consommation de la viande de porc et la chair des animaux sacrifiés autrement que par la saignée. Il interdit également la consommation des animaux impurs : reptiles, insectes, oiseaux de proie, et les carnivores en général. Quant au gibier, il devait être rituellement saigné une fois capturé.
Sur le plan agricole, le pays va connaître une très grande pauvreté amorcée sous les Byzantins. Il faudra attendre le milieu du IX e siècle, sous les Aghlabides pour voir la prospérité régner de nouveau. On ne retrouve plus certes la technicité agricole romaine, les aqueducs, et les systèmes de captage des eaux ne sont plus entretenus et beaucoup de terres sont abandonnées. Kairouan gardera sa suprématie jusqu’à l’arrivée des Hilaliens venant d’Egypte. L’arboriculture et le travail des champs subirent alors un recul. Jusqu’à la fondation de la dynastie Hafside au début du 13ème siècle, où jardins et vergers réapparaissent autour des grandes villes imprimant cette physionomie à toute la région nord de Tunis.

Les céréales restaient la production la plus importante : blé dur exclusivement, le blé tendre apporté par les Romains avait été éliminé par les conquérants. L’orge supplantait le blé là où il y avait plus de sécheresse et un sol moins gras et servait à l’alimentation du peuple car moins cher que le blé. Le sorgho et le millet étaient aussi cultivés.
Après la période florissante qu’elle a connue aux temps des Romains et des Byzantins, la vigne a régressé. Les Arabes qui ne toléraient que les raisins de table et le jus non fermenté, avaient réduit les vignobles. Sous les Hafsides seule Djerba, en continuait et préparait des raisins secs.

La culture des dattiers va se développer à partir du 12ème siècle cantonnée à Gafsa, Djérid, Djerba, El-Hamma et Gabès. En dehors du fruit, on en utilise la sève fermentée, le lâgmî.
De nouvelles espèces d’arbres fruitiers sont importées comme les orangers et les citronniers et des croisements donneront naissance à de nouvelles variétés. Les figuiers vont couvrir de grandes étendues. On en tire le souwâk, écorce avec laquelle se frictionnent les gencives et les dents. Le noisetier disparaît à partir de l’époque hafside. Le pistachier demeure dans la région de Gafsa jusqu’au 13ème siècle. Le caroubier, consommé broyé sous forme de farine, est signalé au début du 16ème siècle. Il y a également le jujubier, les citrons doux, les cédrats, pêches, abricots, prunes, cerises, azeroles, nèfles, pommes, poires, amandes, grenades, mûres blanches et mûres noires. Les jardins potagers avoisinent les villes et on y cultive toutes sortes de légumes : fèves, haricots, lentilles, pois chiches, aubergines, navets, choux, choux fleurs, blettes, pourpiers, laitues, chicorées, asperges, carottes, ail, oignons, concombres, melons et pastèques.
Il faut signaler aussi la culture des plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales comme le cumin, le carvi et l’anis, le henné, le safran, l’origan, la myrte, le jasmin, les rosiers, le narcisse, le nénuphar, la jaune, la giroflée, la marjolaine, la violette, le lis, le thym, le pavot somnifère et le chanvre indien. Certaines denrées étaient importées comme les noix, amandes, châtaignes et le vin d’Italie pour la consommation des juifs et des chrétiens ainsi que l’huile d’olive. Des épices arrivaient d’Orient : poivre, clou de girofle, gingembre, noix de muscade, casse, manne, rhubarbe, safran, aloès, mastic.

L’alimentation demeurait, à peu d’exception près, végétarienne, on consommait plus d’orge que de blé parce que l’orge était moins cher sous forme de bsîsa ou de bouillie d’orge.
Après l’époque hafside, on assiste à un renouveau partiel de l’agriculture en Tunisie. Mais le véritable changement sur le plan alimentaire et culinaire a lieu avec l’arrivée des Andalous. C’est un véritable tournant et on imagine mal aujourd’hui ce qu’a pu être la cuisine tunisienne avant l’introduction des espèces américaines : par exemple sans tomate et sans piment.
Les Andalous
L’afflux des morisques d’Espagne évalué à près de 120.000 dès 1608 appartenant à diverses couches sociales, enrichit la vie économique, culturelle et spirituelle du pays et propagea des modes de vie d’un genre nouveau à empreinte surtout citadine. Des maraîchers, des fabricants et des petits industriels introduisirent leurs multiples produits nouveaux et transmirent leurs méthodes de fabrication. Les agriculteurs, s’acclimatèrent dans les plaines du Nord de la Tunisie. La transmission de plants nouveaux, de procédés d’irrigation, de travail du sol, de formes d’exploitation, d’un bon choix des semences, de méthodes artisanales ou industrielles pour transformer les produits agraires, de l’extension de modes de vie tout à fait nouveaux, tout cela équivalait pour le Nord du pays à une révolution agraire et alimentaire.

Cette révolution s’explique d’abord par l’importation d’Espagne de plants venus du Nouveau Monde et qui étaient encore inconnus dans la Méditerranée orientale : le maïs, les tomates, la pomme de terre, le piment, la figue de Barbarie, originaire du Mexique, les diverses espèces d’haricots (haricots latins, haricots panachés), certaines espèces de courges, le myrte d’Inde occidentale, le paprika, de nouvelles espèces d’oliviers, de nouvelles variétés de plantes potagères distinction entre la « blette andalouse » et la « blette indigène. L’abricot de l’espèce « primeur de Murcie », les amandes de type « amandes de Valence » et « amandes de Malaga ». La vigne fut réintroduite sous les Hafsîdes avec les premiers immigrants andalous et connut une large diffusion à partir du 17ème siècle. A côté de l’élevage traditionnel des taureaux ou des bœufs et de celui des moutons, les Andalous pratiquaient comme une innovation l’apiculture.
Dans certains cas, il s’agit de réimportation comme le cas du riz par exemple, qui n’avait plus du tout été cultivé depuis le 14ème siècle et qui se propagea comme une culture nouvelle. Il ne fut introduit que très lentement à travers l’Espagne et le Sud de l’Italie, bien qu’il soit utile d’indiquer que son apparition en Espagne remonte à l’époque wisigothe où sa culture demeura exceptionnelle et assez tardive. En Italie, sa culture est attestée à partir du XIIIème siècle. Dans les préparations et les confections domestiques, qui incombaient surtout aux femmes, on peut noter de nombreuses importations de particularités andalouses :
fabrication des gâteaux, de produits laitiers : fromage et beurre salé, de pâtes alimentaires, hlâlim, dwîda, de beignets isfanj, de sirop de fruits et de nouvelles méthodes de conservation et de stockage de mets finis ou semi-finis.
Les Andalous avaient ainsi amené une reconversion du mode d’alimentation dans son ensemble, lequel reposait jusque-là sur la semoule. Marquant d’une manière décisive le mode culinaire tunisien. On peut affirmer sans exagération aucune qu’en matière d’alimentation et de cuisine, il est permis de parler de l’avant et de l’après l’arrivée Andalous.

Les temps modernes
Les temps modernes sont surtout la grande époque des boissons coloniales : chocolat, café, thé, qui s’introduisent dans le régime alimentaire et tiennent une place déterminante dans le commerce au long cours et dans la rivalité entre les puissances impériales de l’époque.
2. Le peuple de l’Olivier
S’il était un peuple de l’olivier, ce serait le peuple tunisien. Sa relation à l’huile d’olive est unique. La Tunisie est un petit pays grand producteur oléicole du pourtour de la Méditerranée. La dimension de cette oléiculture est essentiellement liée à des conditions climatiques qui ont favorisé le développement de l’olivier, mais aussi à une histoire qui a grandement contribué à la prospérité de cette culture malgré les vicissitudes du temps. Phéniciens, Berbères, Romains, Arabes, les Andalous ainsi que les colonisateurs français, avaient tous contribué à la consécration de la tradition oléicole de la Tunisie. Chaque peuple, chaque conquérant a vécu sa propre aventure, a tissé son propre récit de cet arbre ancestral qui a survécu à tous les bouleversements. Aussi, retracer l’histoire de l’olivier tunisien revient à parcourir les grands moments de l’histoire de ce pays et au-delà.
A l’origine, la culture de l’olivier est liée au travail effectué par les Phéniciens qui amenèrent l’olivier au VIème siècle av. J.-C. Puis, les Romains qui étendirent sa culture. Ensuite les Andalous qui ont introduit de nouvelle méthodes de culture. Enfin, les colons français par la mise en place de nouveaux vergers.
L’olivier est connu depuis les temps les plus reculés de l’histoire. Dès le IIIe millénaire, la Syrie et la Palestine ont produit de l’huile à partir des olives. A Ougarit, une ancienne cité située dans l’actuelle Syrie, ont été découvertes des traces d’installations servant à la production de l’huile ainsi que de très nombreux fragments des grandes jarres destinées à le contenir. La présence de l’olivier est attestée en Egypte sous Ramsès II. Une des premières mentions de l’olivier se trouve dans la Genèse : c’est l’épisode de Noé lâchant la colombe qui revient avec un rameau d’olivier. Il est devenu l’arbre sacré de la terre de Canaan.
D’après la Bible, le roi Salomon envoyait de l’huile à Hiram Ier roi de Tyr, en échange des matériaux et des artisans qu’il destinait à la construction du Temple.
Chez les Juifs, l’huile symbolise la richesse qui ne peut être que le signe de la bénédiction divine (Deut., XXXIII, 24 ; Psaume, XLV, 8). L’usage a perduré, dans les communautés juives d’Afrique du Nord, de répandre de l’huile dans chaque pièce d’une demeure que l’on inaugure. L’huile servant à l’allumage rituel doit être rituellement pure, soumise à des critères très rigoureux et la seule autorisée étant l’huile d’olive.
Dans le Coran, Dieu jure par l’olivier, l’associant au Mont Sinaï, et le cite à plusieurs reprises comme signe de Son infinie bonté.
Au nom de Dieu : celui qui fait miséricorde le Miséricordieux.
Par le figuier et l’olivier !
Par le Mont Sinaï !
Par cette cité où règne la sécurité !
Oui nous avons créé l’homme
Dans la forme la plus parfaite ;
Puis nous l’avons renvoyé au plus bas des degrés,
A l’exception de ceux qui auront cru
Et qui auront accompli des œuvres bonnes,
Car une récompense sans fin leur est destinée.
Qu’est-ce donc, après cela,
Qui t’incite à traiter de mensonge le jugement ?
Dieu n’est-il pas le plus juste des juges ?
Trad. D. Masson.
C’est sans doute en Crète que les Grecs ont de bonne heure connu l’olivier. Ce sont aussi les Grecs qui ont introduit la culture de l’olivier en Italie et dans les îles méditerranéennes, Sardaigne, Sicile, où l’on retrouve la trace du nom gréco-romain : olea. L’olivier, dont l’extension suit la colonisation, joue un rôle non seulement dans l’alimentation mais aussi dans la vie quotidienne, en particulier dans les bains et les sports. La cuisine se fait essentiellement à l’huile d’olive. La friture, surtout celle des poissons, est pratiquée à partir du Ve siècle avant J.C. L’introduction de l’olivier en Afrique est attestée en Kabylie où l’olivier cultivée est appelé zitoun et l’huile zit, mots d’origine sémitique répandus dans toute l’Afrique du Nord. C’est donc par l’entremise des sémites, donc des Phéniciens, que les Berbères ont appris à cultiver l’olivier et à le développer. Parlant de l’île de Cyraunis, identifiée à la plus grande des Kerkenna, Hérodote dit qu’elle était couverte d’oliviers cultivés et de vigne. Nous avons également des preuves de l’existence à Carthage de champs plantés d’oliviers dont l’extension était limitée au Tell tunisien.
Bien qu’il ait une incidence limitée sur leur alimentation, l’olivier pesait d’un poids important sur l’économie des villes étrusques, en particulier dans les régions méridionales dont les excédents de production étaient destinés à l’exportation. Il existe divers témoignages sur le rôle des olives dans l’alimentation. Dans son De agricultura 58, Caton note à propos de la nourriture destinée à l’esclave que les olives ont une haute teneur en protéines.

Avant l’arrivée des Romains en Afrique, la culture de l’olivier y était connue, mais longtemps confinée sur la côte et n’avait pas l’importance qu’elle a prise plus tard. Pour les Romains, l’unique intérêt de l’Afrique était le blé, l’huile n’étant qu’un produit accessoire.
En Italie, suite aux guerres civiles qui avaient déchiré le pays, les campagnes s’étaient dépeuplées et les champs furent laissés en friche. Partout où poussaient les oliviers, s’installaient les pâturages alors que la consommation en huile augmentait et la pénurie s’installait. L’Afrique offrit alors pour Rome un site très favorable à la culture de l’olivier et une occasion de mettre en valeur ses possibilités. Les Romains allaient trouver le terrain préparé et profiter de l’expérience punique pour étendre la culture de cet arbre peu exigeant à toute l’Afrique.
Décrivant la Tunisie, l’historien romain, Salluste (-86/-35), n’y avait vu qu’un désert :
« La mer, y est orageuse, la côte sans port, la terre fertile, propre à l’élevage, sans arbres, sans eaux de pluie, sans sources (…) Au milieu de vastes déserts s’élevait une grande et forte ville, appelée Capsa ».
C’est à l’époque de l’empereur Tibère, (42 av. J.-C. – 37 ap. J.-C.), que l’on s’est rendu compte du parti que l’olivier permettait de tirer du pays. D’où la mise en valeur de l’Ifriqiya. Des villes comme Thysdrus (El-Djem) Suffetula (Sbeïtla), Cillium (Kasserine), Thelepte (Fériana) doivent leur puissance et leur renommée à l’olivier et aux cultures fruitières.
« L’olivier est de tous les arbres celui qui occasionne le moins de dépenses, bien qu’il tienne le premier rang. Quoiqu’il ne produise pas de fruits tous les ans consécutivement, mais généralement de deux années l’une, il n’en mérite pas moins une grande attention, parce qu’il ne réclame que peu de travail. Il paye du reste par une ample récolte la dépense qu’on fait pour lui ».
Columelle, L’économie rurale, V-IX.

C’est surtout Hadrien (76-138), qui a visité l’Afrique en 128, et qui fut frappé par l’immensité des terrains encore en friche, qui donna à la culture de l’olivier l’impulsion nécessaire. Cette politique s’est poursuivi jusqu’à Septime Sévère (145-211). C’est à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle et grâce à la politique agraires de la dynastie des Sévères qui avaient réussi à assurer la paix à l’Afrique tout en augmentant ses richesses, qu’on place généralement l’ère du plus grand développement de la culture de l’olivier. Cela prouve à quel point la culture de l’olivier est tributaire du climat général du pays et du degré de confiance de l’exploitant en l’avenir.
« L’extension de la culture de l’olivier est donc une preuve de saine économie, de tranquillité, c’est aussi une preuve de bonne administration, de mainmise romaine. Le paysan africain est de lui-même amené à planter des oliviers parce qu’il a confiance. Dès qu’un arbre est cultivé, cela prouve que le propriétaire ne vit plus au jour le jour, qu’il espère en l’avenir, qu’il espère récolter dix ans plus tard les fruits de l’olivier planté. Cette confiance prouve la paix romaine, c’est-à-dire une administration et une politique solidement établies dans un pays dont l’histoire est une suite de flux et de reflux du nomade contre le sédentaire ».
Henriette Camps-Fabrer, L’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine, Alger, 1953, p. 24.
Le pillage perpétré par les Vandales n’a pas entamé l’armature agricole qui permit au pays, lorsque l’occupation byzantine se manifesta en 534, de connaître la prospérité de jadis et ce jusqu’au début du 8ème siècle. A partir de l’époque flavienne, la répartition des cultures n’obéissait plus au souci de ravitailler Rome, mais tenait aussi compte de la rentabilité économique. Cette orientation ne fut pas sans conséquence sur la géographie des paysages agraires. Ainsi, progressivement, l’olivier supplanta le blé. Des variétés d’oliviers furent sélectionnées et la fabrication de l’huile améliorée.
A la fin de la domination byzantine, l’économie de l’Ifriqiya était déjà dans une décadence relative. Sans aggraver les choses, la conquête arabe, par sa longueur, son acharnement, ne dut pas lui être des plus bénéfiques, poussant certains historiens à la considérer comme une phase qui est venue aggraver la situation antérieure.

Pourtant, d’abondants témoignages archéologiques suggèrent la continuation de l’activité économique dans des zones plus tard appelées à connaître une incontestable régression, comme le centre-ouest de l’Ifriqiya.
Les conquérants arabes, en foulant le sol de l’Ifriqiya, furent émerveillé de tant de verdure qui value à la Tunisie d’être surnommée al-Khadhra, la verte. C’est que, entre la description de Salluste, qui n’y avait vu qu’un désert, et la conquête arabe, le pays s’est couvert de vergers d’oliviers et d’arbres fruitiers du fait surtout de l’effort de l’homme et non pas d’un quelconque don de la nature.
Les deux siècles de troubles qui suivirent l’invasion des Vandales avaient été fatals à la culture de l’olivier. La demande des marchés de Rome et de Constantinople s’est tarie et les routes pour acheminer l’huile coupée. Les cultivateurs s’étaient alors résignés à retourner à l’élevage, abandonnant leurs vergers. Seule la forêt entre Sfax et el-Djem est restée intacte. Mais, malgré tout, l’agriculture était restée à la base de l’économie et l’Ifriqiya le domaine de l’arboriculture sèche ou irriguée. Il n’est pas de source qui ne vante pas sa prospérité ; comme le laisse penser l’épisode du noyau d’olive rapporté par Ibn ‘Abd al-Hakam qui a grandement valeur de symbole : celui d’une oléiculture riche et profitable.
Comme des Afâriqa déposaient devant ‘Abd Allâh ibn Sa’d un tas de pièces d’argent, il demanda : « D’où cela vient-il ? » L’un des Afâriqa se mit à fureter…trouva une olive (un noyau d’olive) et, la montrant à ‘Abd ‘Allâh : « Voici, dit-il, la source de notre argent ». Comme ‘Abd Allâh s’étonnait, l’homme lui expliqua que les Rûms et les habitants des Îles, qui n’ont pas d’olives chez eux, ont coutume de venir en ifrîqiya acheter de l’huile, ce qui fait la fortune de la région. Est-ce cette constatation de l’abondance des cultures qui fit germer chez les Arabes l’idée d’une colonisation de peuplement ?
Citée dans J. Thiry : Le Sahara Libyen dans l’Afrique du Nord Médiévale, Peteers Press 1995, p. 69.
L’arrivée, au milieu du XIe siècle, en Ifriqiya de tribus nomades arabes, les Banû Hilâl et les Banû Sulaym, connus pour leurs pillages, livra l’Ifriqiya à l’anarchie, fit périr ce qui restait des forêts, s’attaquant aux vastes terres de parcours, dévastant les cultures, saccageant les jardins, ne laissant pas un seul olivier sur leur chemin, rompant l’équilibre auquel étaient parvenus nomades et sédentaires berbères. De vastes domaines cultivés, qui vivaient jusqu’alors en symbiose avec les agglomérations urbaines, dont ils ravitaillaient les marchés, retournèrent à la steppe.
De 1574 à 1590, le pays se réorganise sur le plan politique et économique. Le commerce s’est développé grâce notamment au rétablissement de la sécurité dans le pays, sur les routes et dans les ports, grâce aussi à la construction de souks, l’organisation des foires, et l’établissement de nombreux négociants étrangers. A l’intérieur du pays, la population reste toutefois dépendante d’une agriculture peu rentable.
L’implantation de colonies andalouses dans les régions les plus riches a initié une révolution agricole, diversifiant les cultures et usant de techniques modernes plus productives. Ceux parmi les morisques qui avaient échappé aux meurtres et aux naufrages, furent bien accueillis par le dey Othman qui leur fit distribuer les premiers secours et les établit dans les campagnes environnantes. C’est à cette communauté, à son dynamisme que l’on doit, en grande partie, les plantations d’oliviers de Soliman, Belli, Grombalia, Turki, Zaghouan, Testour, Tébourba, Ghâr al-Melh.

Le protectorat. En occupant la Tunisie, les Français avaient saisi tout le parti qu’ils pouvaient tirer de l’amélioration de la culture de l’olivier. Ils entreprirent alors de ramener le pays à un état de culture qu’il a déjà connu une fois, c’est-à-dire du temps de la paix romaine.
Les grands domaines oléicoles, que l’on confond volontiers avec la forêt renommée de Sfax, ont leur origine dans la colonisation de cette région à partir de 1892. Profitant de l’œuvre commencée par les Tunisiens et de leur compétence incontestable dans le domaine de l’oléiculture, les autorités françaises engagèrent un vaste programme de plantation. Établi d’abord pour Sfax, il s’étala ensuite à travers la steppe, dans toutes les directions. L’aspect du grand domaine qui, en général, demeure toujours entre les mains des familles des fondateurs, contraste avec celui de la petite propriété propre à la région du le Sahel. C’est Paul Bourde, nommé en 1890 en Tunisie directeur des Renseignements et du contrôle de l’agriculture, qui a réintroduit la culture de l’olivier à Sfax contribuant énormément à son essor.
«L’époque où l’on a commencé les plantations a laissé un souvenir assez précis dans la mémoire des Sfaxiens. Elle se place entre 1800 et 1810. On planta d’abord très peu et mal, sans ordre, à distance trop faible, suivant les anciennes méthodes en usage dans la Régence. Puis, vers 1840, les premiers résultats ayant appris aux habitants quels bénéfices on pouvait tirer de cette culture, le mouvement s’accentua. Vers 1850, quelques hommes, parmi lesquels on cite El-Haj Mohammed Ettriki, encore vivant aujourd’hui, ayant observé avec soin ce qui avait été fait jusqu-là, remarquèrent quelles commodités la symétrie parfaite donne pour la culture et combien les arbres largement espacés devenaient plus beaux et produisaient plus de fruits que ceux qui sont serrés ». Paul Bourde, Rapport sur les cultures fruitières et en particulier sur la culture de l’olivier dans le centre de la Tunisie, Tunis, 1899, p. 28.
Statue de Paul Bourde (1851-1914)

La culture. Outre cet effort préalable d’aménagement des sols, qui n’était d’ailleurs pas nécessaire partout, la culture de l’olivier doit se plier à un certain nombre de conditions, qui n’ont guère varié depuis l’Antiquité et qui sont valables pour l’ensemble des pays producteurs.

Une telle culture n’était pas à la portée du petit paysan, qui ne peut subsister sur une terre improductive pendant 10 ou 12 ans, car en zone semi-aride l’olivier n’admet aucune culture intercalaire, et n’a pas les moyens d’embaucher au moment de la récolte le nombre d’ouvriers nécessaires. Bourde en vient à conclure à la nécessaire intervention du grand propriétaire, seul capable de faire face à ces lourdes charges et pour qui l’olivier représente au contraire un placement sûr et fort économique. D’où l’intérêt du système d’exploitation alors en vigueur appelé mghârsa.
Deux systèmes étaient en usage pour l’exploitation de l’olivier :
* Le système de mghârsa est une sorte de métayage entre un propriétaire et un autochtone ; le propriétaire fournit à l’autochtone le terrain et ce dernier donne son travail et complante le terrain. Lorsque les oliviers commencent à produire, ou plutôt lorsque les produits arrivent à payer les frais d’entretien, c’est-à-dire au bout d’une dizaine d’années, le partage de l’olivette a lieu par moitié ; en dehors du terrain, le propriétaire fait encore à son mghârsî une avance d’argent en vue de lui permettre d’acheter les animaux de trait et le matériel nécessaires à l’exploitation du sol. Cette avance lui est du reste remboursée au moment du partage, soit en argent, soit en nature, c’est-à-dire en oliviers pris sur la part du mghârsî.
* Le système d’exploitation direct, surtout employé par les grands propriétaires terriens, se fait au moyen d’un gérant installé sur la propriété et qui se charge, au frais du propriétaire, du défrichement, de la mise en culture et de la plantation des oliviers. Le gérant touche un traitement assez faible, mais il avait droit, après une période de dix ans, au huitième ou au dixième de la surface plantée.
La fabrication. Produit d’usage courant, la fabrication de l’huile, familiale ou destinée au commerce, a suscité des inventions qui ne sont pas moins importantes que celles que l’on peut suivre avec l’histoire du moulin à grain. La plus ancienne meule à rotation actuellement connue, trouvée dans la ville d’Olynthe, en Grèce, et donc antérieure à 348 av. J.-C, était destinée au broyeur à huile.

L’exemple du pressoir à huile illustre pertinemment le cadre méditerranéen imposé par la culture de l’olivier, la simplicité des manœuvres à effectuer sans interventions chimiques, permettent de dégager des données constantes à travers une longue période. La succession des trois opérations à effectuer est bien connue des Méditerranéens :
une fois les olives ramassées, il faut les broyer pour faire éclater la chair afin que l’huile puisse se dégager
- c’est le détritage -. La pâte recueillie après ce broyage est ensuite portée sous le pressoir. Une lente pression exprime à la fois l’huile et l’eau de végétation, (les margines). Enfin ces liquides recueillis sont décantés, avec l’eau ajoutée au cours des presses successives.
Les vestiges des huileries antiques qu’on découvre en Tunisie indiquent que la technique de l’oléifaction n’a guère changé depuis 2000 ans. Pendant longtemps, on n’a fait qu’adapter les machines aux nouvelles sources d’énergie mises en œuvre pour les actionner. Ainsi l’extraction de l’huile à partir des olives se fait toujours mécaniquement et en trois temps.
C’est dans l’antiquité que furent inventés les pressoirs à vis, pour l’huile et le vin. Le pressoir à arbre et à vis, utilisé au premier siècle, l’est encore au XXe. Pendant deux millénaires ces deux grands types ont donc cohabité et aucun n’a évincé l’autre. Tous les deux ont pu être utilisés pour l’huile et le vin, chacun a connu des améliorations et des variations locales, mais les deux lignées ont coexisté, dans les mêmes régions aux mêmes époques.
De l’antiquité, le sud tunisien a conservé le procédé d’extraction par l’eau ou darb el ma. On a continué à utiliser la presse de l’époque romaine, avec son moulin en pierre, m’dar, et une presse fabriquée à l’aide d’un tronc de palmier, ma’asra. On emploie une bête (mulet ou chameau) pour actionner le broyeur et des hommes pour les leviers des pierres.

L’introduction des machines européennes, après 1881, a peu influencé la production autochtone. Néanmoins, l’orientation de la production vers une meilleure qualité et la nécessité d’une fabrication plus rapide de plus grandes quantités, provoquèrent l’expansion de ce qu’on appelait la «méthode européenne » ou makîna sûrî. Aux environs de 1881, les machines à vapeur font leur apparition dans le Sahel et à Sfax. Par la suite, le mazout et l’électricité sont introduits. A la veille de l’occupation, toute l’huile était obtenue dans des moulins à énergie animale, mais qui, n’occupait plus, à la veille de l’indépendance qu’une part infime. Dans les villes, ou dans les petits villages, les pressoirs se fondaient encore récemment dans le tissu urbain. L’intensité du mouvement dans les ruelles et l’odeur des grignons indiquaient au passant la présence d’une makina arbî. Au début de chaque campagne, des familles viennent encore s’approvisionner auprès des meuniers pour leur autoconsommation.
L’industrie de l’huile longtemps représenté pour le Tunisien, dans certaines régions, une activité économique quasi exclusive, mobilisant des milliers d’ouvriers : laboureurs, cueilleurs, ouvriers d’huileries, commerçants. En 1950 plus de 500.000 Tunisiens vivaient de l’oléiculture. Si les opérations de labour et de taille requièrent peu de main-d’œuvre, la récolte et le pressage qui les suivent immédiatement exigent beaucoup d’ouvriers. Le coût de la main-d’œuvre nécessaire au ramassage seul représentait depuis toujours plus de 50 % des frais de production. Le personnel permanent d’une huilerie ne suffisant pas à ces travaux il faut recruter des ouvriers saisonniers. Leur qualification et leur honnêteté, restent un souci constant depuis Caton jusqu’aux grands propriétaires du XIXe siècle. C’est qu’en effet le pressurage de l’huile est une activité temporaire mais demande une main-d’œuvre relativement importante et une surveillance soutenue. Les fraudes sur la quantité d’huile pressée sont possibles aussi bien de la part des ouvriers que de la part du propriétaire du moulin lorsque celui-ci fonctionne pour autrui.
Le marché de l’huile d’olive
À la fin du XIV siècle, l’huile d’olive ne figurait pas sur la liste des produits exportés, elle était au contraire importée et ce n’est qu’à la fin du XIII siècle qu’on la voit figurer dans les exportations vers l’Occident.
Aux XIIIe et XIVe siècles, les auteurs arabes notaient la présence d’olivettes dans les régions côtières, mais ce thème avait disparu au XIV siècle, ce qui suggère une certaine dégradation de l’oléiculture dans les temps d’anarchie qui suivent le départ des Fâtimides. La progression des Almohades venus du sud du Maghreb occidental, en rétablissant une paix relative entre les villes et les campagnes, les sédentaires et les nomades, permit la reprise de l’oléiculture, avec des résultats tangibles à partir du milieu du XIII siècle.
Au début du XXe siècle, l’huile d’olive produite en Tunisie est destinée à alimenter un marché intérieur et un marché extérieur où s’écoule, en principe, le surplus. De nombreux petits propriétaires se contentent de triturer leur propre huile et vendent le surplus de leurs olives, qui gagne d’ordinaire les circuits commerciaux, mais peut également être vendu à un autre propriétaire ou à des ouvriers. De même entre usiniers, y compris familles, parents et amis, s’établissent de nombreuses tractations. A l’issue de ces échanges apparaît l’épicier ou le détaillant, qui vend l’huile aux particuliers à Sousse ou dans les autres agglomérations.
En 1900, grâce à l’outillage moderne, le taux d’extraction moyen varie, suivant les régions, de 17 à 25 kg d’huile comestible par 100 kg d’olives. Quant à la production totale, elle oscille entre 300.000 et 400.000 hectolitres d’huile, dont un peu plus de la moitié est consommée sur place, le restant servant à alimenter, au gré des besoins, le commerce extérieur. Les huiles d’olives tunisiennes prenaient presque exclusivement jusqu’au début du siècle, le chemin de la France, où elles bénéficiaient d’un régime douanier de faveur. Les expositions internationales leur ont fourni des occasions de se faire connaître et apprécier à l’étranger.
Depuis elles trouvent des débouchés sans cesse plus importants, en Italie et dans le Nord de l’Europe.
Le marché extérieur
L’huile tunisienne a toujours fait l’objet de grands efforts en vue de son exportation.
En 1907, la Tunisie a exporté 3. 580 tonnes d’huile d’olive à destination de :
- Angleterre : 15 T.
- Malte : 393 kg.
- Italie. 2. 750 T.
- Norvège : 190. Kg.
- Autres : 222 kg.
Des huiles pures au moment de l’exportation, mais qui subissent fréquemment à l’étranger, divers coupages qui en diminuent les qualités et en modifient la composition.
3. Il n’est d’huile que d’olive
Les utilisations pratiques de l’olive et de son huile sont connues et multiples, en ce qui concerne la vie quotidienne des peuples de la Méditerranée : à son usage quotidien comme nourriture et condiments, éclairage et chauffage, baume médicinal, parfums et onguents, s’ajoute son utilisation en temps de guerre. Souvent, durant les sièges, les assiégés livraient l’ultime combat en versant de l’huile bouillante sur leurs assaillants. L’utilisation rituelle de l’olivier et son huile à des fins religieuses est attestée dans le monde gréco-romain tout comme dans le judaïsme d’époque biblique ou gréco-romaine. C’est toujours du blé ou l’huile qui sont offerts à des fins rituelles ici et là.
Pour le Tunisien, il n’est d’huile que d’olive. Et nul autre que lui ne sait en faire usage, surtout en cuisine. L’huile d’olive lui offre ainsi une gamme tout à fait originale, utilisable soit comme condiment, soit comme aide culinaire. Sur les 80 recettes sucrées, recensées par Moh. Kouki dans son recueil de recettes tunisiennes, Ommok Sannâfa, il y en a 17 où l’huile d’olive intervient obligatoirement : ghrayba, baklawa, maqroudh, zlâbia, qrouss, masfouf aux grenades ou aux raisins secs, bsîssa, etc. Car l’huile d’olive a toujours été l’aliment de base des Tunisiens comme corps gras exclusif. On en abuse même pour la cuisine. Tous les ragoûts ou presque, les potages, les bouillons, les salades, les viandes et les poissons, frits ou cuits au four, les rissolés, les soufflés, sont tous à base ou font appel à l’huile d’olive : slata mechouia arrosée d’huile d’olive, le poisson grillé arrosé d’une huile parfumée au jus de citron encore vert, les différents couscous et la fameuse mloukhiyya.
La cuisine tunisienne est d’abord une cuisine économique. En quantité puisqu’on ne préparait qu’un seul plat pour la journée, et en qualité car elle était à la fois à dominante végétarienne et inventive dans le cadre d’une alimentation surtout tributaire des aléas de la production. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où production et distribution sont non seulement maîtrisés mais orientée par les préférences alimentaires.
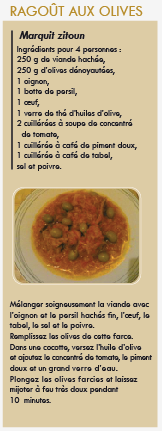
D’après le répertoire culinaire s’imposent d’emblée la marqa :
un plat mijoté où se trouvent associés viande et légumes dans une sauce. Ils sont innombrables, toujours épicés avec le pain qui leur sert de complément. Les plus fins, sont incontestablement la gnawiyya, ragoût aux gombos. Probablement originaire de l’Inde, cette plante aurait atteint la Tunisie dans les mêmes conditions que la mloukhiyya corète potagère, par l’Orient. La préparation de la mloukhiyya ne comporte aucune autre légume que la poudre de feuilles de corète, cuite dans l’huile d’olive avec de la viande de bœuf, quelquefois des tripes ou de la chair de jeune chameau. Marqat khodhra à base de bettes, pois chiches, haricots blancs; marqat oummâlah à base de variantes, madarbil à base de courgettes, liftiyya à base de navets, mermez ragoût de pois chiches et viande et miththâwma, ragoût de pois chiches avec cette fois des tripes.

Lorsque la viande fait défaut on se contente d’une tebîkha dans laquelle le qaddîd ou les merguez de conserve remplacent avantageusement la viande : tebîkhet khodhra (à base de blettes, épinards, persil, fèves et pois) ou tebîkhet qraa’ (courges rouges), etc. Dans cette liste de plats de sauce figure en dernier la chakchouka, préparation intermédiaire entre la tebîkha et la marqa. Très bon marché, rapide à la cuisson, à base de légumes, elle exclut à son tour la viande et se contente d’œufs. Elle se prépare avec des fèves sèches (bissara), des fèves vertes, des courges, des choux fleurs, des pommes de terre, des tomates et poivrons. Dans le chapitre des pâtes s’impose le couscous dont la notoriété dépasse aujourd’hui les frontières de son pays d’origine puisqu’il est le premier plat consommé en France ! C’est un mets dont la préparation permet de nombreuses variantes selon la saison, la région, l’occasion et le moment de la journée. Excepté le couscous au poisson, toutes les autres variétés s’accompagnent de lait caillé râib mais surtout de lben, babeurre ou lait aigri privé de sa matière grasse par l’extraction du beurre. C’est une boisson très digeste, rafraîchissante. De la semoule cuite à la vapeur on tire le mesfouf servant à préparer les plats sucrés :
au sucre, aux raisins frais et secs, aux grenades, aux dattes ainsi qu’avec du lait et du sucre. Viennent ensuite les potages à base de céréales comme le sdir, les variétés de chorba : sha’îr, thrîd, hsou, mechalwish, aux pâtes comme lsân ‘asfour, etc. En plus des nombreuses variétés de couscous et des différentes qualités de pâtes comme les mhames (pâtes coupées en lanières, comme les nouilles des Européens, et qui peuvent être après séchage cuites de la même façon que les mhammes) et ses multiples variétés bîlkhodhra, bîl-dabâbish (légumes secs et qaddîd), maqrouna, dwida, richta, nawâsir ou hlâlim (petites pâtes séchées faite à partir d’une pâte à pain), qui forment le noyau central de cette cuisine, défilent la grande variété de tajîn (du nom de l’ustensile dans lequel il cuit qu’il soit en argile ou en cuivre étamé), plat rissolé qui cuit entre deux feux et qui prend les appellations des ingrédients utilisés comme le tajine aux épinards, au persil, aux pommes de terre, au fromage, aux anchois, tajîn zdef à base d’œufs crus et d’œufs durs, de fromage, de beurre et de thon ; tajîn barânes où l’on mêle variantes et olives, tajîn fraîtla à base de pommes frites. De même que les soufflés appelés ma’qûda aux mendoles séchées (jamour), à la cervelle ou aux abattis de volailles (bil quwâniz).
Voyons quelle place tient la viande dans cette cuisine. Ce qui est devenu aujourd’hui un important attribut de la cuisine tunisienne comme les côtelettes grillées koustilliyât, le moslî fî l-koucha épaule d’agneau rôtie, le méchoui ou les brochettes sfâfed étaient exceptionnels et réservés aux grandes occasions. Bien que présente dans bon nombre de recettes, la viande fraîche en général ne jouait pas un rôle important et n’apparaissait chez la majorité que les jours de fête. D’un bout à l’autre de ce répertoire, le mouton règne en souverain, sa chair est la plus consommée et participe à plus de deux fois sur deux à la composition des plats à base de viande. Moins appréciée par rapport à la viande d’agneau ou de mouton, plus délicate, la viande bovine, grosse viande qui offre plus de chair, est aujourd’hui plus compatible avec une cuisine moins élaborée. Le poulet, quant à lui, fut longtemps une viande de luxe réservé aux occasions composant par exemple le menu de la fête de la ‘achoura. L’usage de la volaille était rare en effet et le poulet considéré comme un supplément diététique servant à rehausser le statut gastronomique du court-bouillon (broudo, de l’italien brodo) plutôt que nourriture ordinaire.

La préparation du poisson a été longtemps le domaine des villes côtières, principalement Tunis et Sfax. Quant aux divers modes de préparation, ils ont été le plus souvent le fait des spécialités des communautés étrangères qui peuplaient la Tunisie. Pour preuve, la quantité d’emprunts de noms de poissons de l’italie au tunisien : bouga, trîliya, skombrî, gombrî, soubiyâ, nazallî, warrâta et balmita pour blamîta. Quant aux legs portugais et espagnols, nous le retrouvons chaque fois que nous consommons le bakalaw, morue salée. Poisson de haute mer, de la même famille que le nazallî. Le cabillaud – c’est le nom qu’il porte quand il est à l’état frais-, séjourne chaque année quelques temps sur les côtes espagnoles pour frayer. Ce sont probablement les Portugais qui l’ont introduit chez nous, comme le prouve l’adoption de l’appellation bakalaw.

S’il est aujourd’hui consommé essentiellement en bouillie, à Sfax, particulièrement le jour de la fête de l’Aïd el-Séghir, pour accompagner la charmoula rituelle. On apprécie sa chair blanche, friable une fois cuite à point. Pour réussir une bonne cuisson de ce poisson, il faut le tremper la veille dans l’eau froide pour qu’il ramollisse et perde une partie de sa salinité. Une fois dessalée et bien égoutté, la morue est accommodée de mille façons : cuite à l’eau simplement, frite après avoir été roulée dans la farine et les œufs battus, en salade avec un oignon et du persil finement hachés et, enfin, en boulettes frites.

C’est en matière d’assaisonnement qu’ont lieu les modifications les plus dramatiques qui attestent d’une véritable mutation du goût. Sucrer les plats passe de plus en plus, ici comme ailleurs pour une faute de goût. Le sucre ne s’emploie désormais que pour édulcorer ou dans la pâtisserie. Ainsi ont déserté la cuisine tunisienne un grande variété de mets aigre-doux comme les marqat qastel (agneau aux châtaignes), marqat ‘aounina (agneau aux prunes), marqat sfargil (agneau aux coings, mishmashiyya (agneau aux abricots), mrouziyya (agneau aux amandes), aqîd (agneau aux raisins secs) et la chermoula sfaxienne, préparée avec un gros poisson salé dans une sauce où s’associent oignons, épices poivrées, cumin, vinaigre et raisins secs.

La désaffection du peuple pour le sman (beurre cuit, très acide) au profit du beurre frais prive certains plats comme le couscous, le riz à l’agneau et les viandes cuites au four d’un complément indispensable. La liyya, queue grasse du mouton de Barbarie, équivalent du lard en Europe, faisait partie de toutes les grillades et merguez, entrait dans la farce des andouillettes et dans la préparation des gâteaux salés et du pain gras mbasses. Bien que toujours employées, le nombre des épices et condiments divers, s’est considérablement réduit. Ils ne font plus partie du paysage aromatique et leur usage dans la cuisine s’est considérablement réduit. De ces épices, la nouvelle génération ignore jusqu’à leur nom : ce lexique de l’univers lui échappe comme ne les enchantent plus l’évocation des graines de paradis, galanga, macis, cardamome, anis, cumin, cannelle, graines de fenouil, boutons de rose chouch al ward, gingembre associé à la crème de sorgho, clou de girofle, etc.

Jusqu’aux lendemains de l’indépendance, la communauté juive occupa une place importante dans la société tunisienne et sa présence était un élément important du paysage urbain. Leur engagement séculaire dans le grand et dans le commerce de détail de la capitale était important occupant des souks entiers. A ce commerce des souks, relativement prospère, s’ajoutait celui des échoppes de boucherie, épicerie, commerce de détail et des vendeurs ambulants pour satisfaire aux besoins permanents de la hâra surpeuplée.
En Tunisie, si l’on exclut le caractère cachère de la nourriture, le menu quotidien des juifs ne se révèle pas très différent de celui des Musulmans. A part quelques mets propres à la cuisine juive comme la shminka, plat très recherché, ragoût longuement mijoté à base de tripes de bœuf cuites avec des piments rouges secs, de l’ail, du coriandre, de la sauce tomate, du poivre, du laurier, de la menthe, les ‘oqod, qui une sorte de shminka, où l’on ne garde que les portions de tripes, en laissant de côté le bouillon servie accompagnée de la Boukha. La tahfîfa, des choux et de la courge coupées et frites dans de l’huile avec un peu d’harissa, du sel, de la viande grasse et une poignée de coriandre. La medfouna, des épinards ou de la blette frites dans l’huile avec des haricots blancs, de la peau ou un pieds de bœuf grillés et bien raclés. La mennina, un mets très prisé, présents dans les grandes festivités et réjouissances familiales à base de viande et de chair de poulet hachées frites dans de l’huile le tout mélangé à la cervelle de bœuf, de la cannelle, du sel, du safran ainsi que des œufs durs entiers et d’autres coupés en deux ou en quatre et porté au four. Il faut citer aussi les ka’âbir, le msouqqi et une préparation très particulière du couscous, tout le reste obéit au même mode de préparation, sollicite les mêmes ingrédients et fait partager aux juifs comme aux musulmans, les mêmes plaisirs gustatifs.
4- Une huile qui résiste
La Tunisie a toujours eu, et possède encore, une vocation agricole ; grenier à blé des Romains, Ifriqiya bienheureuse des Arabes, sont autant de définitions qui font penser que le pays était un producteur important de denrées alimentaires diverses. Mais la production agricole n’a pas toujours été régulière, et le pays a affronté dans son histoire tourmentée plusieurs périodes de pénuries, de disettes et de famines qui n’ont pas été sans conséquences sur ses choix ni sur ses habitudes alimentaires.
Jusqu’au XIXe siècle, partout dans le monde, les populations consommèrent des matières grasses de production locale. Certes, un commerce de ces substances avait existé dès les temps très anciens, tel celui de l’huile d’olive dans la Méditerranée antique. Plus tard, les marchands de la Hanse assurèrent les transactions sur les graines de lin de Russie, sur le lard et les suifs de l’Europe du nord, mais elles n’atteignirent jamais de gros tonnages. Aussi, en Europe de l’Ouest, les pays méditerranéens étaient voués à l’huile d’olive et ceux du Nord aux corps gras d’animaux, ainsi qu’aux huiles fluides de colza, d’oreillette, de lin et de chanvre.
La révolution industrielle créa des besoins nouveaux. Pour répondre à la demande, il fallait aller chercher les matières grasses nécessaires en Afrique australe guinéenne avec l’huile de palme, et accessoirement en Inde, avec l’huile de coco.
Les XIXe et XXe siècles sont aussi la grande époque des oléagineux tropicaux : huile d’arachide, en particulier, a durement concurrencé l’huile d’olive, l’huile de noix et autres huiles traditionnellement consommées en Europe, tandis que végétaline et margarines fabriquées à partir d’autres plantes tropicales ont fait reculer le beurre et les graisses animale. En ce domaine, des graisses les pays européens ont inversé la tendance en fin de siècle, opposant le colza puis le tournesol aux oléagineux tropicaux en décrétant l’huile d’arachide dangereuse pour la santé.

Des huiles végétales sont introduites donc en Tunisie au début des années 1960 pour produire de l’huile de mélange. C’est tout d’abord sous forme de dons alimentaires que furent connues ces huiles végétales dans une société qui jusqu’alors consommait uniquement de la graisse animale et de l’huile d’olive produite localement. Après une phase initiale d’accoutumance, ce type d’huile a pu gagner des parts de marché en Tunisie du fait que les prix à la production de l’huile d’olive ont grimpé et les prix de l’huile de mélange ont été maintenus à des niveaux nettement plus bas. Ainsi, la Tunisie, un des plus grands producteurs d’huile d’olive au monde, s’était mise à subventionner sa consommation locale d’huile de grains (soja et colza) désormais importée afin de réduire la consommation intérieure d’huile d’olive, dégager ainsi d’importants excédents exportables et promouvoir l’afflux de devises.

L’Office National de l’Huile (ONH) approvisionne les raffineries privées en huile brute de graine importée et récupère l’huile raffinée pour la vendre aux grossistes et détaillants. La différence entre le prix d’achat aux raffineries et le prix de vente aux distributeurs (inférieur au coût de revient) tous deux fixés par l’Etat est remboursé à l’ONH par la CGC. Mais les justifications économiques n’ont cependant pas entamé la réticence ni la résistance farouche rencontrées au départ qui n’ont été vaincues que par la perception de pressions monétaires indiscutables.
Les appels réitérés faits au public pour l’encourager à consommer davantage d’huiles végétales devaient fluctuer au gré des caprices du marché international. En effet, à partir du milieu des années 70, aux restrictions imposées par la CEE entravant les exportations tunisiennes d’huile d’olive, s’est associé le renchérissement des prix à l’importation d’huiles de graines.

Le résultat fut alors un excédent énorme d’huile d’olive aggravé par une succession de campagnes exceptionnelles et une population qui a fini par s’habituer, entre temps, au goût d’une huile végétale au prix abordable.
On se mit alors à encourager la consommation d’huile d’olive. Mais une décennie plus tard, suite à une discordance entre prévision et production réalisée au niveau mondial et avec à la reprise des exportations, cette incitation à la consommation d’huile d’olive fut abandonnée, son cours ayant retrouvé et même dépassé ses plus hauts sommets passés. Pour vaincre encore une fois la réticence du public et encourager, pour la seconde fois, la consommation d’huiles végétales, sans pour autant discréditer définitivement l’huile d’olive, on invoqua comme argument le préjugé, fort répandu d’ailleurs, que les ménagères tunisiennes s’en servaient pour la cuisson de tous les plats alors qu’il ne fallait jamais cuire l’huile d’olive. Plus tard, suite aux difficultés d’écoulement sur les marchés extérieurs, on a vu se manifester de nouveau une volonté d’inciter la population à renouer avec les habitudes du passé, en la poussant à inverser le sens de la substitution. Une campagne publicitaire a été lancée pour vanter, cette fois, les multiples vertus de l’huile d’olive, du reste incontestables, et les prix à la production ont été ramenés en 1998-99 à un niveau nettement plus bas comparativement aux campagnes précédentes. A grand renfort d’arguments médicaux et diététiques, on s’est mis à louer la saveur de l’huile d’olive, citant ses caractéristiques chimiques et physiques supposée, la différencier nettement des autres huiles végétales et des graisses d’origine animale. On rappela qu’elle est riche en acide oléique et pauvre en graisses saturées, que ses bienfaits sont incalculables : combat le vieillissement de l’organisme, régularise la glycémie et améliore le diabète, contrôle le fonctionnement digestif, etc.
Dans les pays industrialisés, confrontées aux maladies dites de civilisation : affections cardio-vasculaires par artériosclérose et les cancers ; deux pathologies responsables des deux tiers de la morbidité des pays riches, des maladies le plus souvent dues aux excès alimentaires de toutes sortes et à des déséquilibres nutritionnels, on oppose la cuisine occidentale à la cuisine méditerranéenne. Celle-ci répond sur le plan diététique par le recours à certains aliments plutôt qu’à d’autres : céréales, légumes et fruits, vin à petite dose et surtout l’huile d’olive, alicament qui protège les artères, l’estomac et le foie, favorise la croissance et prolonge l’espérance de vie. En conseillant aux gens de réduire drastiquement les apports en corps gras de notre alimentation, apanage de la diète occidentale : trop de graisses saturées au détriment des graisses mono et poly insaturées, pas assez de fibres, trop de sucres simples et pas assez de sucres complexes et surtout faire le choix des graisses qui ne présentent pas de danger pour le corps. L’huile d’olive se retrouve dans ce contexte l’objet d’un engouement jugé parfois excessif, en tous les cas elle occupe désormais une place de choix. On conseille alors et on souhaite que les pays industrialisés s’orientent vers une alimentation de type méditerranéen.





















